En 1852, le professeur Antonin Macé, parfois connu sous le nom de Macé de Lépinay, breton d'origine, veut signer son entrée dans le Dauphiné en permettant à bon nombre de ses nouveaux concitoyens d'accèder à un texte qui n'était alors disponible qu'en latin. Il s'agissait du premier livre de l'Histoire des Allobroges d'Aymar du Rivail, écrit dans la première moitié du XVIe siècle en latin, premier livre qui donnait une description du pays des Allobroges et de certains de ses confins, autrement dit du Dauphiné, de la Savoie, du nord de la Provence (le Comtat-Venaissin) et de la Bresse.
C'est ainsi qu'est paru en 1852, chez les libraires Charles Vellot et F. Allier :
Description du Dauphiné, de la Savoie, du Comtat-Venaissin, de la Bresse et d'une partie de la Provence, de la Suisse et du Piémont au XVIesiècle; Extraite du premier livre de l'Histoire des Allobroges par Aymar Du Rivail, Traduite, pour la première fois, sur le texte original publié par M. Alfred de Terrebasse; précédée d'un introduction et accompagnée de notes historiques et géographiques par
M. Antonin Macé, Ancien élève de l'école normale supérieure, Professeur d'histoire à la Faculté des lettres de Grenoble
Grenoble,
Ch. Vellot & Cie, libraires, F. Allier père & fils, imprimeurs, 1852, in-8°, XXXVI-364 pp.
Il s'agit de la traduction du premier livre de
l'Histoire des Allobroges
d'Aymar du Rivail, qui donne la description d'une vaste zone couvrant
la Savoie et le Dauphiné, en y incluant la Bresse au nord,
et le Comtat-Venaissin au sud. Ce texte, écrit dans la
première moitié du XVIesiècle,
a d'abord été publié en 1844 dans sa version
latine, ce qui le rendait
guère accessible au public cultivé,
interessé par l'histoire de la région. Antonin
Macé a entrepris de le traduire, complété de
notes, pour le faire connaître au public dauphinois.
Récemment arrivé dans la région, c'est sa
première contribution à l'histoire régionale.
Dans cette volonté de mettre à disposition du
plus grand
nombre un texte qui était inaccessible à la
plupart,
parce que publié en latin, on peut y voir une application
pratique des idées libérales et
démocratiques
d'Antonin Macé. Cela va dans le même sens que les
cours
populaires qu'il délivrera de 1854 à 1875 pour
mettre le
savoir historique à la portée de tous.
Dans son Avant-propos, A.
Macé se faisait le promoteur des guides régionaux
: "Avec leur esprit pratique, les Anglais ont, dans leurs Hand-Books,
d'excellents modèles d'une classe intermédiaire
de livres
que je voudrais qu'on imitât en France. Moins secs, moins
arides,
moins hérissés de chiffres et de tableaux que nos
Statistiques,
ils sont bien autrement sérieux et instructifs que nos
prétendus Guides
du voyageur.
On y trouve des notions simples, précises, exactes, sur la
géographie physique de chaque pays, c'est-à-dire
sur les
montagnes, les vallées, les golfes, les îles, les
fleuves,
les cours d'eau; sur les canaux, les routes et leurs relais,
les
chemins de fer, les distances relatives des villes et même
des
villages; les antiquités, les monuments, les
souvenirs
historiques; le commerce, l'industrie, l'agriculture; le tout
accompagné de plans, de cartes, de vues admirablement
exactes,
et dans lesquelles l'art ne perd rien quoiqu'il n'emprunte rien
à l'imagination." Par cet ouvrage,
il
espère contribuer à cela. Il trace aussi
la voie aux
futurs ouvrages qu'il fera paraître. En effet, c'est le
premier
travail publié par Antonin
Macé, breton d'origine, que le hasard des affectations a
conduit en Dauphiné, région à
laquelle il
s'attachera et dont il deviendra un des promoteurs. Ce premier ouvrage
est aussi un façon de faire connaître le
passé et
la diversité de la province. Plus tard, il sera un des
pionniers du tourisme en Dauphiné par ses guides des chemins
de
fer, puis ses deux plaquettes sur les montagnes de Saint-Nizier et
surtout sur Belledonne. Sur ce dernier point, il sera même un
des
pionniers de la découverte et de la promotion des Alpes
dauphinoises.
Je vous laisse découvrir cet ouvrage, dans la description que j'en ai donnée (
cliquez-ici). Comme on l'imagine, si tout le département des Hautes-Alpes est bien représenté, la description des montagnes est totalement absente. Le seul sommet cité est le Mont-Viso. Malheureusement, Antonin Macé ne nous renseigne guère. Sa note sur le Vénéon montre que la topographie
de la région était encore très
approximative pour notre savant, ce qu'il partage avec les autres
écrivains sur les Alpes dauphinoises, jusqu'aux
années 1860 : "Le Vénéon
formé de deux torrents le Vénéon
proprement dit, qui prend sa source à la pointe de Chiare,
le Lavet, qui sort de la pointe de la Muande dans le mont.Pelvoux, la
plus haute montagne de France ( 4 300 mètres ).
Après sa jonction avec le Lavet, le
Vénéon arrose les vallées de
Saint-Christophe et de Venosc en Oisans, et va enfin se jeter dans la
Romanche un peu au-dessus du Bourg-d'Oisans."
Les notes d'Antonin Macé sont souvent très instructives, bien que très érudites. Les deux notes renvoyées en appendices sont :
Des divers
systèmes sur le passage des Alpes par Annibal. Les contradictions d'Aymar du Rivail à ce
sujet sont l'occasion, pour Antonin Macé, de
développer largement ses réflexions et son
opinion sur le passage d'Annibal. Il se range à
l'hypothèse du passage par le Mont-Cenis, en
s'appuyant en particulier sur l'ouvrage de Larauza. Les
hypothèses par les cols des Hautes-Alpes
(Monte-Genèvre, Mont-Viso, Queyras, etc.) sont
réfutées et discutées.
Des routes actuelles
dans les Alpes, qui contient en particulier un
développement sur la route du
Mont-Genèvre.
Pour mieux connaître Antonin Macé de Lépinay, je lui ai consacré une notice biographique, complétée d'une bibliographie. Vous pouvez la consulter en
cliquant ici. J'ai trouvé beaucoup d'informations dans la consultation de son dossier numérisé de la Légion d'Honneur, consultable sur Internet.
Antonin Macé de Lépinay (1812-1891)
Le manuscrit original d'Aymar du Rivail
a
été publié pour la première fois
par Alfred de
Terrebasse, en 1844, après avoir retrouvé la
partie qui
avait disparu. Cette publication a reproduit le texte latin, avec des
notes en latin. Seule l'introduction est en français, avec
quelques éléments sur la vie d'Aymar du Rivail.
Cette
belle publication, sortie des presses de Louis Perrin, était
réservée à des érudits :
Aymari Rivallii [Aymar
du Rivail], Delphinatis. De Allobrogibus. Libri
novem. Ex autographo codice Bibliothecae Regis editi. Cura et Sumptibus
Aelfredi de Terrebasse [Alfred de Terrebasse].
Viennae Allobrogum, apud Jacobum Girard, bibliopolam [Vienne, Jacques
Girard, Libraire], 1844, in-8°, [6]-XXVII-608 pp.
Pour voir la notice,
cliquez-ici et le messages sur ce blog :
"De Allobrogibus", une édition de 1844, des presses de Louis Perrin

Pour finir, cet ouvrage, bien relié, a d'abord appartenu à Laurent de Crozet, puis à son fils Amédée de Crozet et enfin à Charles Schefer, comme l'indique les trois
ex-libris héraldiques disposés en colonne, par
ordre chronologique des propriétaires de haut en bas, sur le premier contre-plat.
J'ai rassemblé quelques éléments sur ces différents propriétaires :
cliquez-ici.
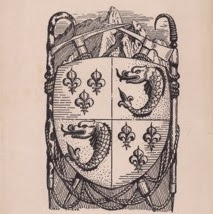
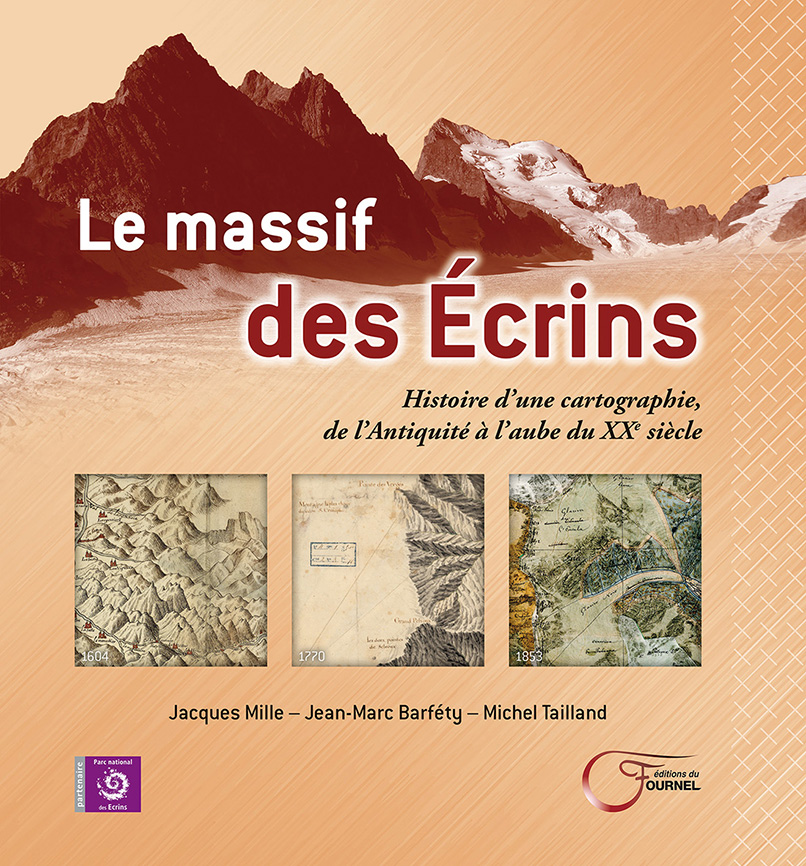
_-_S%C3%A9pulture_au_Cimeti%C3%A8re_de_Montmartre_(Paris_9e).jpg)
































































