En 1843, le pharmacien grenoblois Hippolyte Bouteille s'associe à Eugène de Rivoire, marquis de La Batie, "agronome distingué" et à Victor Cassien pour faire paraître en 2 volumes un inventaire de plus de 300 espèces d'oiseaux observables dans l'Isère, la Drôme et les Hautes-Alpes, illustré de 72 planches lithographiques d'après des dessins de Victor Cassien.
C'est l'exemplaire personnel d'Eugène de Rivoire de la Batie qui vient de rejoindre ma bibliothèque.
On distingue son supralibris au chiffre E. de R. L.
doré au centre des plats supérieurs. L'ouvrage a ensuite appartenu à la bibliothèque ornithologique de Paul Lebaudy :
C'est un ouvrage relativement courant, très recherché pour ses illustrations : "Une des plus intéressantes parmi les faunes locales est
certainement l'Ornithologie
du Dauphiné avec des figures
dues au crayon tout à la fois si pur et d'une expression si
suave du dauphinois Victor Cassien. Délicatement reproduites
(lithographies de C. Pégeron) d'après nature et
agrémentées souvent d'un paysage quelque peu
romantique, elles sont d'un effet très doux, bien que les
oiseaux soient de formes très
élancées. Les 300 sujets représentent,
en 72 planches, un spécimen de chacune des
espèces décrites."(Ronsil, L'art
français dans le livre d'oiseau. p. 67,
n° 361)
Grenoble,
Hip. Bouteille, Pharmacien et
les principaux libraires de la ville, 1843, in-8°, 2 volumes :
- 416 pp, 37 planches
lithographiques hors texte
- 358 pp, 35 planches lithographiques hors texte, un tableau
dépliant hors texte in fine.
Cette sélection de 4 planches parmi 72 donne une idée précise de la qualité et de la beauté des lithographies de Victor Cassien :
Voici ce qu'en dit le rédacteur du catalogue de la vente Perrin (n° 114) : "Nous ne craignons pas de donner cet ouvrage
comme l'œuvre
la
plus fine du crayon de V. Cassien. Dans les
paysages de l'
Album duDauphiné et de l'
Album du Vivarais,
l'auteur put – chose permise – faire quelques pas
à côté du sentier, souvent un peu
aride, de la réalité : il put, ici, planter un
arbre
absent
et, là, enlever un bloc de rocher
présent,
parce que celui ci gatait et que
celui-là faisait le tableau, mais dans l'
Ornithologie il dut
rester simplement et rigoureusement copiste de la Nature et il le fut
avec une délicatesse remarquable."
Il existe quelques exemplaires avec les
gravures tirées sur
chine. L'exemplaire d'Eugène de Rivoire de La Batie en fait partie. Il y a aussi de très rares exemplaires aux
gravures rehaussées de couleurs et gommées
d'époque.
Les lithographies ci-dessus proviennent d'un deuxième exemplaire que je possède, dans une jolie reliure romantique. Surtout, comme on peut le voir, c'est un exemplaire dénué de rousseurs.
Deux après la
parution
de cet ouvrage, Hippolyte Bouteille en a donné une version
courte,
essentiellement destinée aux taxidermistes, avec les 72
planches
de l'édition originale :
Manuel de
l'ornithologiste préparateur, contenant la
collection complète des oiseaux du Dauphiné
dessinés par V. Cassien.
Grenoble, Chez H. Bouteille, 1845, 36 pp., 72 planches.
Il reproduit les pages introductives du premier volume (Classe des Oiseaux,
Anatomie
et physiologie et Taxidermie),
complétés par l'ensemble des planches de
l'ouvrage. Certains exemplaires se présentent sous un
cartonnage d'éditeur, orné de motifs romantiques
dorés, comme celui que je possède.
Pour aller plus loin, reportez-vous aux notices de l'
Ornithologie du Dauphiné (
cliquez-ici) et du
Manuel de l'ornithologiste préparateur (
cliquez-ici).
Pour finir, la description de ces ouvrages ont été l'occasion de faire une recherche sur Eugène de Rivoire, marquis de La Batie. Premier défi, trouver ses dates et lieux de naissance et décès. Adolphe Rochas donne la date du 13 septembre
1785, sans précision de lieu. Sur Internet (Geneanet et autres), on trouve
indifféremment Grenoble et Bourgoin comme lieu de naissance.
Lors de son premier mariage (Lyon, 12 mai 1824), il est dit
être né à Bourgoin le 17 septembre 1789
et lors de son second mariage (Proulieu (Ain), 10 mais 1841), le lieu
et la date sont Bourgoin le 23 août 178... et la fin de la
date n'est pas lisible sur le registre numérisé ! Pour le décès, on trouve généralement Bourgoin, le 31 janvier 1879. Des recherches dans les registres paroissiaux et l'état civil permettent d'affirmer qu'il est né le 17 septembre 1785 à Grenoble, sur la paroisse Saint-Hugues, et qu'il est décédé aux Eparres (Isère) le 31 janvier 1879, à 93 ans. Il est le père du célèbre auteur de l'Armorial de Dauphiné, Gustave de Ravoire de La Batie. J'aurais ainsi modestement contribué à rétablir quelques vérités !
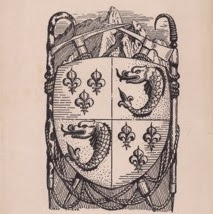
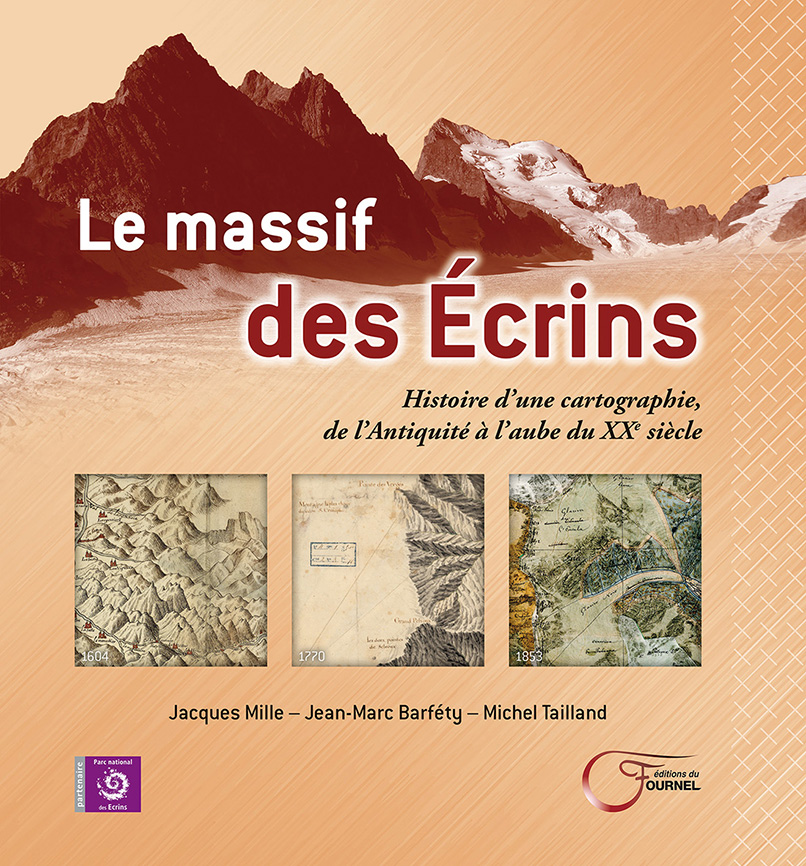
_-_S%C3%A9pulture_au_Cimeti%C3%A8re_de_Montmartre_(Paris_9e).jpg)




































































