Poésies en langage patois du Dauphiné, Grenoble, Prudhomme, 1829, qui contenait trois pièces majeurs en "patois" de Grenoble :
- Grenoblo malhérou, de Blanc La Goutte.
- Dialoguo de le quatro commare, de Blanc la Goutte.
- Monologue de Janin, de Jean Millet.
En 1840, Paul Colomb de Batines publie les trois textes de l'édition de 1829, avec une préface, dans une nouvelle édition : Poésies en patois du Dauphiné. Edition publiée par Colomb de Batines, Grenoble, Prudhomme, 1840.
En 1859, le libraire Alphonse Merle reprend les 3 textes des éditions de 1829 et 1840, en les complétant de quelques textes supplémentaires en "patois" du Dauphiné et une relation, en français, des inondations de l'Isère le 2 novembre 1859 :
Poésies en patois du Dauphiné. Deuxième édition revue et augmentée.
(voir une notice détaillée en cliquant-ici).

L'attribution fréquente de cette seconde édition à P. Colomb de Batines est une erreur car, à cette date, il était décédé, erreur due à la reprise dans cette édition de la préface de Paul Colomb de Batines de l'édition de 1840.
C'est un exemplaire relié par Trautz-Bauzonnet qui vient de rejoindre ma bibliothèque :

Dilemme
Je possédais déjà un exemplaire broché de cet ouvrage. En toute logique, il devrait être relégué au second rayon, voire revendu, tant un exemplaire relié par Trautz-Bauzonnet ne peut que prendre le pas sur un exemplaire broché. Malheureusement, les couvertures n'ont pas été conservées. Et pourtant, elles sont belles, représentatives de l'art typographique de l'époque. Je vous laisse admirer la belle composition des deux couvertures, le bel encadrement du titre, lui même décliné selon une grande variété de polices de caractères. J'ai un prédilection particulière pour ces travaux typographiques :


Autre attrait de cet exemplaire broché, il contient encore le catalogue de la librairie Alphonse Merle de Grenoble ajouté en fin de volume.
En définitive, il n'y a pas de dilemme, je garde les deux !
Billet d'humeur
J'ai acheté cet exemplaire dans une vente aux enchères récente. La description du lot par l'expert était : "Demi maroquin saumon, dos à nerfs orné, tête dorée. Superbe exemplaire, finement relié par Trautz". On peut discuter la couleur, qui me semble plus havane que saumon. On peut discuter la qualification de "superbe exemplaire", alors que je l'aurai plutôt qualifié de "bel exemplaire". En revanche, on ne peut que constater que le dos n'est absolument par orné, sauf à dire que le titre doré est un ornement. Ou alors, il faudrait dire que le dos et les nerfs sont ornés ... d'épidermures ! (voir le détail sur la photo ci-dessous).

Sur l'édition de 1829 des Poésies en langage patois du Dauphiné, voir ce message en cliquant-ici.
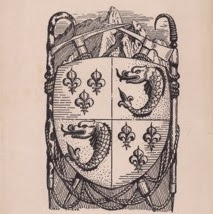
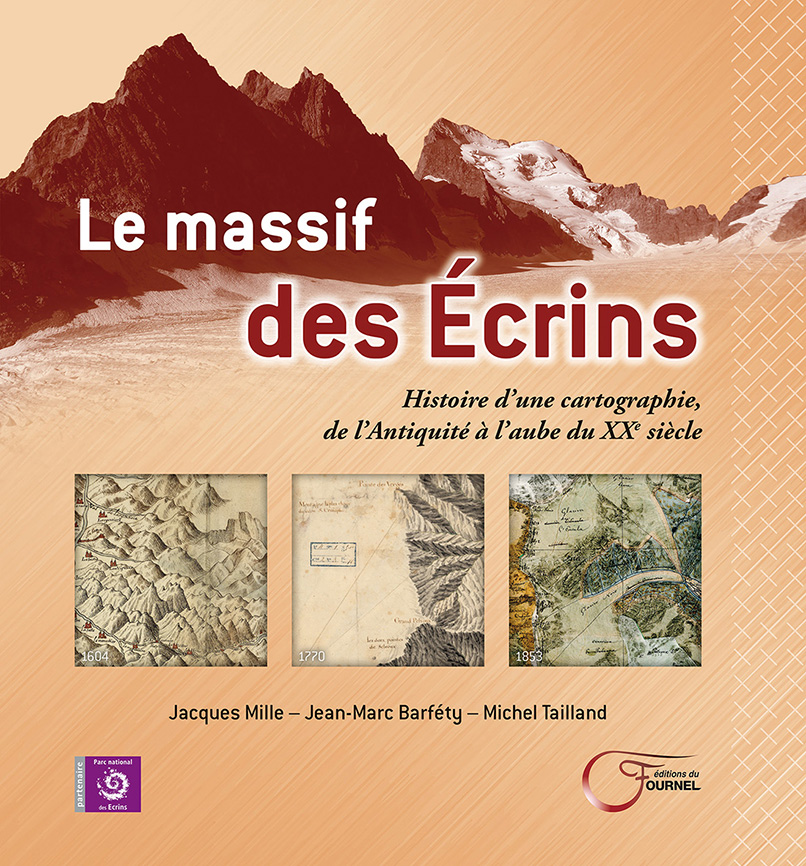
_-_S%C3%A9pulture_au_Cimeti%C3%A8re_de_Montmartre_(Paris_9e).jpg)






















































