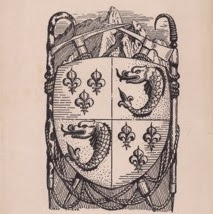Il est parfois rapporté qu'Edward
Whymper aurait découvert qu'il y avait une montagne plus élevée que le
Pelvoux le jour où il a atteint ce sommet en août 1861. Poussant un
peu le raisonnement, on pourrait attribuer à Whymper la paternité
de la découverte du point culminant du massif des Écrins. Il n'en est rien. On ne trouve pas de
telles assertions dans les principaux ouvrages sur le massif, mais
tous rapportent l'anecdote de la surprise de Whymper au sommet du
Pelvoux, en créant parfois une confusion dans les esprits.
Les Écrins, vus depuis le sommet du Pelvoux
(extrait du Tour d'horizon complet du sommet du Pelvoux, par Paul Helbronner, 1934)
Whymper donne le récit de son ascension du Pelvoux dans
Scrambles amongst the Alps (
cliquez-ici). C'est cette phrase qui a créé un
malentendu :
« [Avec ses compagnons d'ascension, ils viennent d'arriver au sommet du Pelvoux] Tandis que près de nous, nous
étions étonnés de découvrir qu'il y avait une montagne qui
paraissait encore plus haute que celle sur laquelle nous étions. Du
moins, c'était mon avis. Macdonald pensait qu'elle n'était pas
aussi haute et Reynaud pensait qu'elle était aussi élevée.
Ce sommet était éloigné d'à peu
près 2 miles et était séparé de nous par un immense abîme dont
nous ne pouvions voir le fond. […] Nous ne connaissions absolument
par les lieux, aucun d'entre nous n'avait été de l'autre côté ;
nous imaginions que c'était la Bérarde qui était à nos pieds,
dans l'abîme, mais en réalité, elle se trouve au-delà de cet
autre sommet. »
[While close to us we were astonished
to discover that there was a mountain which appeared even higher than
that on which we stood. At least this was my opinion ; Macdonald
thought it not so high, and Reynaud much about the same as our own.
This mountain was distant a couple of
miles or so, and was separated from us by a tremendous abyss, the
bottom of which we could not see. […] We were in complete
ignorance of its whereabouts, for none of us had been on the other
side ; we imagined that La Berarde was in the abyss at our feet, but
it was in reality beyond the other mountain]
Cette montagne qu'ils voient depuis le
Pelvoux est le point culminant du massif, la Barre des Écrins. On
peut penser que Whymper laisse entendre qu'il a découvert ce sommet
que personne ne connaissait. En réalité, c'est une lecture
erronée, qui ne correspond pas à ce que dit Whymper. Ce qu'il
explique plus simplement est qu'il a un peu mieux compris la
topographie interne du massif des Écrins. Il n'a pas découvert le point culminant du massif et ne revendique pas cette paternité. En revanche, il a compris, pour son usage personnel, comment les deux sommets se positionnaient l'un par rapport à l'autre. Tout cela est bien différent.
Edward Whymper.
Revenons a ce qu'il
pouvait savoir avant de gravir le Pelvoux durant l'été 1861.
Whymper sait de
façon certaine qu'il existe dans le massif un point culminant,
distinct du Pelvoux. Cela veut donc dire que le résultat des travaux
des ingénieurs de la carte de France sont parvenus jusqu'à lui. C'est ainsi qu 'il
dit :
« Les
plus hauts sommets sont disposés presque en forme de fer-à-cheval.
Le plus élevé d'entre eux est la Pointe
des Écrins, en position centrale ; le second pas la hauteur est
la Meije, au nord ; et le Mont Pelvoux, qui donne son nom au
massif, se trouve presque détaché de cet ensemble, sur
l’extérieur. »
[The highest
summits are arranged almost in a horse-shoe form. The highest of all,
which occupies a central position, is the Pointe des Ecrins ; the
second in height, the Meije, is on the north ; and the Mont Pelvoux,
which gives its name to the entire block, stands almost detached by
itself on the outside.]
En revanche, il
s'était fait une représentation erronée de la relation entre le
sommet du Pelvoux et celui des Écrins. Il imaginait une forme de
continuité qui lui permettrait de passer du Pelvoux aux Écrins.
Malheureusement, avec les informations qu'il avait, il ne pouvait
guère être détrompé.
En effet, il ne disposait que de 3
sources d'informations sur le massif des Écrins : la carte de Bourcet (1758),
les travaux du géologue français Léonce Élie de Beaumont (1834) et le récit du
voyage d'exploration du Dauphiné par le scientifique écossais Forbes, Norway (1853).
Cette
vue de la carte de Bourcet montre clairement qu'elle n'est pas assez
précise pour pour identifier clairement les deux sommets. Elle peut
même laisser entendre qu'il y a une solution de continuité entre le sommet du
Pelvoux (Grand Pelvoux) et le sommet des Écrins (Montagne d'Oursine).
Le propos de L.
Élie de Beaumont est moins topographique que géologique. Il ne
pouvait pas apporter d'informations pertinentes à Whymper pour qu'il
se fasse une conviction sur l'articulation topographique entre le
Pelvoux et les Écrins.
La
lecture de Forbes ne peut pas
non plus détromper
Whymper car, comme nous l'avions noté (cliquez-ici), il ne fait pas le lien
entre la montagne d'Oursine (Les Écrins
– 4 102 m), qu'il voit depuis les Étages et la pointe des Arcines
ou des Écrins, dont il connaît l'existence par les ingénieurs
français, mais qu'il n'a pas vue lors de son passage à Vallouise.
Il sait néanmoins qu'il existe une montagne plus haute que le
Pelvoux, dont l'altitude est de 13 468 pieds (4 105 m.).
Les Écrins , depuis les Étages, par Forbes.
La montagne n'est pas identifiée et encore moins reliée avec le reste du massif.
Sur
place, personne ne peut renseigner Whymper. Les informations qu'on lui
donne sont lacunaires. En
revanche, d'après ce qu'il
rapporte, les habitants savaient déjà qu'il y avait un sommet plus
haut que le Pelvoux, appelé Pic des Arsines, que
celui-ci avait
été identifié par les ingénieurs de la carte de France.
Malheureusement,
aucun ne
savait lui dire comment on pouvait passer d'un sommet à l'autre.
Devant un tel
manque d'informations, il est naturel que Whymper se fasse la
représentation la plus favorable pour ses projets :
« Nous
avions l'impression que le point le plus élevé était dissimulé
par les
pics que l'on voyait [les pointes
du Pelvoux que Whymper voit depuis La Bessée] et qu'il pourrait être
atteint en les dépassant. »
[We were under the
impression that the highest point was concealed by the peaks we saw,
and would be gained by passing over them.]
C'est d'ailleurs
cette représentation erronée qui apparaît dans le compte-rendu
qu'il donne de son ascension dans
Peaks, Passes and Glaciers, en 1862 (
cliquez-ici). Il y a confusion entre un des 3 sommets du Pelvoux et le Pic des Arcines (ou Écrins). Cette erreur de représentation sera corrigée dans
Scrambles amongst the Alps.
On comprend sa
surprise en arrivant au sommet du Pelvoux. Ce qu'il croyait à portée
de main s'avère en réalité un défi tout autre.
C'est
faire un mauvais procès à Whymper que
de lui reprocher
de n'avoir pas accédé
à d'autres sources d'informations. En 1860, il n'existait que ces 3
sources publiques. Il n'existait aucune carte autre que celles de
Bourcet. Mieux, il faut lui savoir gré d'avoir utilisé des textes
mieux informés que la plupart des géographies disponibles en
France.
Il ne
faut jamais oublier qu'Edward Whymper était un homme jeune et de modeste extraction lorsqu'il
arrive dans les Alpes en 1860. C'est
un graveur
sur bois, envoyé dans les Alpes par l'éditeur Longman pour
illustrer une tentative d'ascension du Pelvoux. Dans
une société anglaise très hiérarchisée, cela ne lui permettait
pas d'accéder à des savants ou des institutions qui auraient pu lui
fournir des informations de meilleures sources et lui
ouvrir les portes pour accéder aux
travaux de cartographie du Dépôt de la Guerre. Les
minutes de la carte
d’État-major, telles que nous pouvons les voir aujourd'hui, auraient
levé tous les doutes qu'il avait.
Minutes de la carte d’État-major au 40.000e
où l'on voit distinctement la différenciation entre le sommet des Écrins et le Pelvoux (source : Geoportail).
Mais
comment un graveur sur bois, sans relations,
aurait-il pu accéder à ces renseignements ? Il faudra attendre
Bonney et surtout Tuckett, en 1862, pour que les explorateurs anglais
disposent de ces informations.